SPÉCIAL HALLOWEEN : QUAND LA BANDE DES « CHAUFFEURS D’ORGÈRES » SEMAIT LA TERREUR EN BEAUCE
- Igor Robinet-Slansky

- 18 oct. 2025
- 6 min de lecture
Dernière mise à jour : 25 oct. 2025

Au cœur de la Beauce, tout près de Tillay-le-Péneux, se dresse le château de Villeprévost. Une élégante gentilhommière du XVIIIᵉ siècle, aux façades sobres et harmonieuses, entourée d’un parc à la française. Un lieu paisible, préservé, habité depuis deux cents ans par la même famille.
Mais derrière cette sérénité apparente, le château cache une page d’histoire terrifiante. Car c’est ici, dans le grand salon, qu’en 1798 furent interrogés plus de trois cents membres de la fameuse bande des chauffeurs d’Orgères — des brigands redoutés qui terrorisaient la Beauce à la fin du XVIIIᵉ siècle, en brûlant les pieds de leurs victimes pour leur faire avouer où elles cachaient leurs économies.
LA PEUR DANS LA PLAINE
À la fin du 18ᵉ siècle, la Beauce est prospère : ses fermes regorgent de récoltes et d’argent que les propriétaires terriens cachent où ils le peuvent dans leurs maisons. Mais les campagnes, isolées et mal protégées, deviennent le terrain de jeu idéal des bandits. Dans un contexte de misère et de désordre révolutionnaire, une bande se forme autour d’Orgères-en-Beauce, petit bourg tranquille au cœur du plateau.
Leur surnom fait frémir : les chauffeurs d’Orgères. Leur méthode ? Forcer les fermes, ligoter les habitants et leur brûler les pieds au feu pour leur faire avouer où ils cachent leurs économies. Une violence méthodique, organisée, qui terrorise la Beauce entière.
UNE ORGANISATION BIEN HUILÉE
Loin d’être une simple bande de maraudeurs, les Chauffeurs d’Orgères sont une véritable société criminelle. On y trouve des chefs, des espions, des messagers, des receleurs, des cabaretiers complices. Leur réseau s’étend de Chartres à Montargis, et jusque dans les confins de la vallée de la Loire.
Avant chaque attaque, la bande prépare méticuleusement son coup. Des éclaireurs sillonnent la campagne, repèrent les fermes isolées, observent les habitudes des habitants et évaluent leurs richesses. Le choix de la victime n’est jamais laissé au hasard : il faut des paysans âgés de préférence, aisés, vivant à l’écart.
Les Chauffeurs communiquent par signes convenus : un pan de torchon accroché à une haie, une pierre déplacée sur un muret, un chien attaché d’une certaine manière… autant de messages codés indiquant le moment propice pour agir.
LA NUIT DES ATTAQUES
Tout se joue dans l’obscurité. Vers minuit, les bandits surgissent silencieusement, souvent à pied pour ne pas être repérés. La porte est forcée à coups de barre de fer ou de hache. En un instant, la famille se retrouve cernée. Les hommes sont ligotés, les femmes bâillonnées, les enfants enfermés dans une pièce.
La fouille commence alors : coffres, lits, greniers, granges… tout est retourné. Si l’on résiste ou si la cachette reste introuvable, les Chauffeurs passent à la torture. Les victimes sont pieds nus, maintenues devant l’âtre ou une chandelle allumée ; on approche lentement la flamme des plantes de leurs pieds jusqu’à obtenir un aveu. Cette « chauffe » ne dure que quelques minutes, mais suffit à briser les plus endurcis.
Une fois le butin saisi, la bande se disperse : certains prennent les chemins de traverse pour égarer d’éventuels poursuivants, d’autres rejoignent des relais sûrs où le butin est partagé avant d’être revendu. Le lendemain, on retrouve souvent les maisons pillées, les meubles renversés, et parfois des cadavres.
DES FIGURES PASSÉES À LA LÉGENDE
Parmi ces brigands, plusieurs noms sont restés dans la mémoire beauceronne :
Le Rouge d’Auneau, de son vrai nom François Ringette, meneur redouté, rusé et sans scrupules.
Le « Beau François », surnommé ainsi en référence à sa superbe allure et son charisme.
Fleur-d’Épine, fils du brigand Poulailler, déjà célèbre quelques décennies plus tôt, qui inspira d’autres bandes.
Le Borgne-de-Jouy, espion infiltré, qui finira par trahir ses complices en révélant leurs repaires.
Certains de ces bandits ont tout du roman noir : charismatiques, violents, rusés, souvent sans pitié. Leur réputation dépasse vite les frontières de la Beauce. Dans les auberges et sur les marchés, on raconte leurs méfaits à voix basse, comme pour ne pas les attirer.
VILLEPRÉVOST : LA JUSTICE DANS LE GRAND SALON
Face à la multiplication des attaques, le gouvernement du Directoire (1795-1799) s’inquiète. Deux régiments de hussards sont dépêchés pour sécuriser la région et traquer la bande. Mais c’est finalement une enquête locale qui va tout changer.
Après une nouvelle agression, Amand-François Fougeron, juge de paix du canton d’Orgères, confie les investigations au maréchal des logis Vasseur, de la gendarmerie de Janville. Ce dernier parcourt la campagne et met la main sur le Borgne-de-Jouy, l’un des lieutenants les plus redoutés de la bande.
Sous interrogatoire, le Borgne livre un secret décisif : le projet d’une attaque contre le château de Faronville, près d’Outarville. Une embuscade est aussitôt tendue. Le piège fonctionne : le chef de la bande tombe dans le filet, et les jours suivants, les arrestations s’enchaînent dans toute la Beauce.
C’est alors que le rôle du juge Fougeron devient central. Pour mener les interrogatoires, il réquisitionne son propre château de Villeprévost. De janvier à mai 1798, le grand salon se transforme en salle d’instruction. Près de 300 suspects y sont entendus, parfois cinquante par jour, dans une atmosphère lourde de tension et d’épuisement. Les caves du château, elles, font office de cellules improvisées.
On imagine sans peine la scène : le parquet qui craque, la lueur des chandelles, le froissement des papiers, les gendarmes en faction. Dans cette pièce aujourd’hui paisible, se joua alors l’une des affaires judiciaires les plus retentissantes du Directoire. Le travail acharné du juge permit de démanteler la totalité du réseau.
LE PROCÈS ET LES EXÉCUTIONS
En octobre 1800, la justice tranche. Vingt et un chauffeurs sont condamnés à mort et guillotinés sur la place publique de Chartres. D’autres sont envoyés au bagne ou condamnés à la réclusion à perpétuité. Le Rouge d’Auneau et la Grande Marie figurent parmi les exécutés. Le Beau François, quant à lui, échappera à la mort en s’évadant. On ne le retrouvera jamais.
L’affaire fait grand bruit. Les journaux du temps s’en emparent : la Beauce respire enfin. Mais la peur, elle, mettra du temps à s’effacer, et la légende va s’installer.
LES MASQUES DU SOUVENIR
À Villeprévost, le souvenir des chauffeurs ne s’est jamais dissipé. Dans le colombier du domaine sont conservées les copies des masques mortuaires de plusieurs condamnés – ces masques que l’on affichait pour laisser une trace de la mise à mort des condamnés et mettre en garde la population. Visages figés, traits durs, paupières closes… parmi eux, ceux des trois femmes complices : Madeleine Beruet, dite « la Grande Marie », compagne du Rouge d’Auneau, Élisabeth Tondu, compagne d’André Berrichon, et Victoire Langé.
Le contraste est saisissant : dans ce lieu paisible, où ne reposent habituellement que des volatiles, ces masques rappellent la violence et la misère d’une époque. Certains visiteurs disent ressentir une sensation étrange en entrant, comme si l’ombre des chauffeurs planait encore sur les murs.
ENTRE HISTOIRE ET LÉGENDE
Avec le temps, les chauffeurs d’Orgères sont devenus des figures de légende. On raconte qu’ils auraient enfoui un trésor quelque part dans la plaine – certains le cherchent encore dans les bois alentours -, ou que leurs âmes erreraient encore autour de Villeprévost. D’autres disent avoir aperçu des silhouettes dans le brouillard du matin, sur la route d’Orgères à Tillay…
Mais derrière ces récits, il reste une réalité historique : celle d’une bande redoutable, d’une justice implacable, et d’un château devenu malgré lui le théâtre d’une des plus sombres affaires de la Beauce.
RETOUR À VILLEPRÉVOST
Aujourd’hui, le domaine a retrouvé son calme. Le parc, la chapelle et le jardin à la française offrent une parenthèse hors du temps. Mais dans le grand salon, là où furent interrogés les brigands, le silence semble encore habité.
Et quand le soir tombe sur la plaine, que le vent s’engouffre dans les arbres du parc, il n’est pas impossible d’imaginer l’écho des pas et les murmures des chauffeurs d’Orgères…
L'histoire et ma visite du château de Villeprévost dans l'article dédié sur ce blog.
SOURCES
Visite guidée du château de Villeprévost
La page Wikipédia dédiée
Le site Tourisme Cœur de Beauce
Le site du Mag Centre









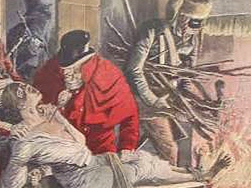













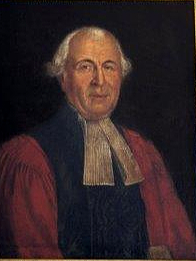













































Commentaires