LE CHÂTEAU DE VERSAILLES FÊTE LES 150 ANS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
- Igor Robinet-Slansky

- 17 févr. 2025
- 10 min de lecture

En 2025, le château de Versailles célèbre un anniversaire historique : les 150 ans de la IIIe République, actée par le vote de l’amendement Wallon dans l’ancien Opéra royal, le 30 janvier 1875.
Cet événement marque la naissance d'un régime qui a profondément façonné l'histoire politique de la France et qui va s’ancrer durablement : la République. À cette occasion, du 15 février à la fin septembre 2025, le château de Versailles propose une riche programmation pour commémorer cette date emblématique et rappeler les événements qui ont conduit à l'instauration de la République française.
Bien que résidence emblématique des derniers rois de France, le château de Versailles a joué un rôle crucial dans l'établissement de la République française. Les transformations de l'Opéra royal et la construction de la salle du Congrès en sont des témoignages tangibles. D’ailleurs, aujourd'hui encore, Versailles continue d'accueillir des événements républicains majeurs, comme les réunions du Congrès pour les révisions constitutionnelles.
En célébrant les 150 ans de la IIIe République, le château de Versailles rend hommage à un moment fondateur de l'histoire politique française et rappelle l'importance de ce lieu dans l'exercice du pouvoir républicain.
Pour ma part, j’ai pu découvrir en avant-première certains des lieux qui seront exceptionnellement ouverts au public pour fêter cet anniversaire unique : la salle du Congrès et l’appartement du Président du Congrès. Mais avant de les découvrir, je vous propose de revenir sur le 30 janvier 1875 et l’avènement de la République française.
30 JANVIER 1875 : L’AMENDEMENT WALLON ET LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le 30 janvier 1875 est une date clé dans l'histoire de la France. Ce jour-là, l'amendement Wallon est voté à Versailles, instaurant l'élection du président de la République par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale.
Cet amendement, adopté à une voix près, marque la naissance officielle de la IIIe République, mettant fin à une période de transition politique tumultueuse – après des siècles de monarchie, la France du 19e siècle voit s’alterner les régimes monarchiques, impériaux et républicains.
LE CONTEXTE HISTORIQUE, DE LA GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE À LA RÉPUBLIQUE
Pour comprendre l'importance de cette date, il est essentiel de revenir sur les événements qui ont précédé le vote de l’amendement Wallon.
DE LA CHUTE DU SECOND EMPIRE AUX NÉGOCIATIONS DE PAIX
Le 2 septembre 1870, la défaite de l’empereur Napoléon III, et donc de la France, face à la Prusse du chancelier Otto Von Bismarck à Sedan entraîne la chute du Second Empire (1852-1870).
A Paris, le 4 septembre 1870, un groupe de Républicains mené par Léon Gambetta proclame la IIIe République. Un gouvernement de Défense National est mis en place, avec à sa tête le général Louis-Jules Trochu, et parmi ses membres Léon Gambetta, ministre de l’Intérieur, ou encore Jules Favre, ministre des Affaires Étrangères.
Mais la situation reste précaire car la guerre franco-prussienne est toujours en cours. L’état-major prussien s’installe au château de Versailles le 19 septembre 1870, le nord de la France est toujours occupé, et Paris est en état de siège. Dans le même temps, une partie du gouvernement provisoire français s’est replié sur Tours puis Bordeaux le 9 décembre.
Ultime humiliation française, le 18 janvier 1871, l’Allemagne proclame son unité au château de Versailles et sacre le roi Guillaume II de Prusse empereur du IIe Reich dans la galerie des Glaces. Finalement, le 26 janvier suivant, après des négociations menées par Jules Favre resté à Paris, l’armistice est signé.
Mais Bismarck n’entend conclure la paix qu’avec un gouvernement et une assemblée officiellement élue par les Français. Le 8 février suivant, des élections législatives sont ainsi organisées. Elles consacrent cependant une majorité de députés monarchistes, compliquant d’une part l'établissement d'un régime républicain stable, mais aussi la perspective de négociations apaisées.
Quoi qu’il en soit, c’est bien le nouveau gouvernement dirigé par Adolphe Thiers, ancien ministre du roi Louis-Philippe 1er (Monarchie de Juillet: 1830-1848), qui est chargé de négocier la paix. Finalement, la France doit payer 5 milliards de francs, et abandonner l’Alsace, la Moselle, ainsi qu’une partie de la Meurthe et des Vosges. Le 10 mai 1971, le traité de Francfort met définitivement fin à la guerre.
DE LA COMMUNE DE PARIS À LA RÉPUBLIQUE
Aussi fragile qu’elle soit, la paix retrouvée conduit le gouvernement et les parlementaires à revenir vers Paris. Mais la capitale est toujours instable, car les Parisiens, n’acceptant pas une paix jugée humiliante, sont en colère. À tel point que le 18 mars 1871, une partie d’entre eux va prendre les armes et s’insurger : c’est l’épisode de la Commune de Paris, un soulèvement populaire contre le gouvernement de Thiers qui fragilisera la République en place entre le 18 mars et le 28 mai 1871.
Dans cette période, le gouvernement et l'Assemblée nationale, ne pouvant siéger à Paris, s'installent à Versailles, après avoir toutefois hésité avec Fontainebleau. L'Opéra royal du château, seule salle suffisamment spacieuse, est alors transformé en salle des séances pour accueillir les 690 députés.
Après la violente répression de la Commune lors de la « semaine sanglante » menée par le général Patrice de Mac Mahon du 21 au 28 mai 1871, le calme revient en France. La situation politique reste pourtant très fragile face aux difficultés qu’ont les monarchistes et les républicains à s’accorder sur la nature du régime à adopter.
C’est dans ce contexte qu’Adolphe Thiers est titré Président de la République. Mais son pouvoir est limité par ceux de l’Assemblée à majorité conservatrice. Il finit par démissionner, et le 24 mai 1873, son successeur est élu. Il s’agit du royaliste Patrice de Mac Mahon, qui promet secrètement aux monarchistes de céder sa place si un roi devait revenir sur le trône.
Les monarchistes sont cependant dans l’incapacité de s'entendre sur un prétendant au trône : les Légitimistes, partisans de la branche des Bourbons, qui rejettent les acquis de la Révolution, souhaitent l’accession au trône d’Henri V (1820-1883), comte de Chambord ; les Orléanistes, partisans de la dynastie des Orléans et désireux de mettre en place une monarchie constitutionnelle, veulent imposer à la tête de la France Louis-Philippe II - Louis Philippe Albert d’Orléans (1838-1894), comte de Paris.
Si le premier, le comte de Chambord, semble en bonne voie, sa vision trop conservatrice et rigide de la monarchie l’empêchera de monter sur le trône. La République a gagné, mais elle est toujours incertaine. Il faut attendre le 30 janvier 1875 et la signature de l’amendement Wallon à Versailles pour que le régime républicain se stabilise définitivement et se dote d’une Constitution.
30 JANVIER 1875 : L'AMENDEMENT WALLON ET LES LOIS CONSTITUTIONNELLES
Comme son nom l’indique, l'amendement Wallon est proposé par Henri Wallon (1812-1904), alors député du Nord. Ce compromis historique vise à instaurer un régime parlementaire bicaméral, dans lequel deux chambres, le Sénat et la Chambre des Députés, réunies en « Assemblée Nationale », élisent le président de la République à la majorité absolue des suffrages.
L'amendement est adopté à une voix près, par 353 voix contre 352. Ce vote serré reflète les tensions politiques de l'époque, mais l’adoption de ce texte majeur marque surtout un tournant décisif dans l’histoire de France. Il met fin à la période de transition politique, et permet d’inscrire pour la première fois le mot "République" dans les lois constitutionnelles de 1875, qui définissent également les pouvoirs des deux chambres et du président de la République. La IIIe République est consolidée, et le régime républicain consolidé.
Trois autres amendements viendront compléter celui d’Henri Wallon pour former la Constitution de 1875 qui restera en vigueur jusqu'en 1940.
UN PARLEMENT BICAMÉRAL
L'amendement Wallon conduit à la création d'un Parlement composé de deux chambres :
La Chambre des Députés : Élue au suffrage universel direct, elle représente le peuple français. Les députés sont élus pour quatre ans et ont le pouvoir de proposer et voter les lois.
Le Sénat : Élu au suffrage universel indirect, il est conçu comme une chambre de réflexion et de modération. Le Sénat est composé de 300 membres, dont 75 nommés à vie (une disposition qui sera rapidement supprimée). Les sénateurs sont élus pour neuf ans, avec un renouvellement par tiers tous les trois ans.
Le Sénat choisit de siéger dans la salle de l'Opéra royal du château de Versailles – qui subit quelques modifications. Et pour accueillir la Chambre des députés, l'architecte Edmond de Joly construit une nouvelle salle en hémicycle dans l'aile du Midi, inaugurée le 8 mars 1876.
RETOUR À PARIS DU PARLEMENT ET VOCATIONS DE LA SALLE DU CONGRÈS
Les élections de 1876 puis 1879, consacrant respectivement une majorité de députés puis de sénateurs républicains, le président Mac Mahon, monarchiste, décide de démissionner. Il est remplacé par le très républicain Jules Grévy, élu le 30 janvier 1879.
La situation politique est désormais stabilisée, et les deux chambres votent leur retour à Paris le 22 juillet 1879 : l’Assemblée nationale au Palais Bourbon, le Sénat au Palais du Luxembourg. Le 14 février suivant, La Marseillaise devient officiellement l’hymne de la République française, et en 1880, le 14 juillet est adopté comme le jour de la fête nationale.
Quant à la salle du Congrès de Versailles, très spacieuse, elle continue de réunir les deux chambres pour l'élection du président de la République jusqu’en 1953.
À partir de 1958 et jusqu’à aujourd’hui, la Constitution de la Ve République prévoit la réunion des deux chambres en Congrès dans cette salle pour adopter des révisions constitutionnelles et, depuis 2008, pour accueillir les adresses du Président de la République aux deux assemblées.
LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS AU CHÂTEAU DE VERSAILLES
Pour célébrer le 150e anniversaire de l’amendement Wallon, le château de Versailles propose plusieurs initiatives ouvertes à ses visiteurs :
Ouvertures Exceptionnelles : Du 15 février à la fin septembre 2025, la salle du Congrès et l'appartement du président du Congrès sont ouverts au public. Ces lieux, témoins de l'histoire républicaine, offrent un aperçu unique de la vie parlementaire sous la IIIe République. Accessibles en visite libre les week-ends avec le billet d’entrée au château, ils sont aussi proposés en semaine en visites guidées thématiques sur réservation.
Toutes les informations et réservations ici, sur le site du château de Versailles.
Visites Théâtralisées : À partir du printemps 2025, des visites théâtralisées et une médiation spéciale permettront aux familles de découvrir l'histoire républicaine du château de manière ludique et interactive.
Podcast : Une série de podcasts permettra de découvrir différents aspects de la République à Versailles, notamment l’épisode de la Commune de Paris et les aspects de la vie parlementaire.
Retrouvez le podcast du Château de Versailles ici.
VISITE DE LA SALLE DU CONGRÈS ET DE L’APPARTEMENT DU PRÉSIDENT
La visite de la salle du Congrès et de l'appartement du président du Congrès est une opportunité rare de plonger dans l'histoire et le patrimoine politiques de la France.
LA SALLE DU CONGRÈS, UN JOYAU DU PATRIMOINE RÉPUBLICAIN
Construite en 1875 en seulement six mois par l’architecte Edmond de Joly, la salle du Congrès est un chef-d'œuvre de l'architecture officielle du début de la IIIe République. Située au cœur de l'aile du Midi du château de Versailles, en lieu et place d’anciens appartements royaux, cette salle impressionnante peut accueillir près de 1 500 personnes (348 sénateurs et 577 députés), surpassant en taille les hémicycles de l'Assemblée nationale et du Sénat à Paris.
DÉCORS ET INSPIRATIONS
Le décor de la salle du Congrès s'inspire du grand appartement de Louis XIV, avec des références nombreuses au Roi-Soleil : des soleils sous les balcons, des colonnes de stuc rappelant le salon d’Hercule et l’Opéra royal. Le style éclectique et palatial de la salle témoigne de la grandeur et de la solennité des lieux.
Le tableau qui surplombe la tribune des orateurs, appelée « perchoir », représente « L’Ouverture des États Généraux dans la salle des Menus-Plaisirs à Versailles, le 5 mai 1789 ». Réalisé par Ferdinand Bassot en 1893, il s’agit d’une copie d’une peinture d’Auguste Couder. De part et d’autre, deux tapisseries des Gobelins de 1680, imaginées par Charles Le Brun, illustrent à gauche « Le Printemps » et à droite « L’Été ».
Au cœur de l’hémicycle, les sièges sont attribués par ordre alphabétique des noms des députés et sénateurs. Au dernier balcon, on retrouve la presse… mais aussi les femmes qui, sous la IIIe République, pouvaient assister aux votes mais ne pouvaient pas encore y participer. Deux loges permettent, en outre, d’accueillir les présidents des deux chambres.
Petite originalité : au-dessus des cartouches des principales villes de France, on voit des double « F » pour « France », mais aucun « RF » pour « République Française », comme c’est habituellement le cas dans les édifices républicains. Pourquoi ? Simplement parce que lors de la création de la salle, on n’était pas certain que la République serait pérenne. On a donc préféré anticiper un éventuel changement de régime.
FONCTION HISTORIQUE
Entre 1875 et 1953, quinze présidents de la République ont été élus dans cette salle. Aujourd'hui encore, elle accueille les réunions du Congrès, où députés et sénateurs se rassemblent pour les modifications constitutionnelles ou les allocutions présidentielles.
Le 4 mars 2024, le Congrès s'y est réuni pour voter l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution.
LA SALLE DU SCEAU
A proximité de la salle du Congrès, la salle du Sceau servait de parloir où le public pouvait rencontrer les députés. Aujourd’hui, on y trouve le sceau utilisé pour authentifier les actes officiels. L'appareil, créé en 1875 par l’ingénieur Guillaume, est une œuvre d'ingénierie impressionnante, pesant 150 kilos.
L'APPARTEMENT DU PRÉSIDENT DU CONGRÈS : UN TRÉSOR MÉCONNU
Moins connu du grand public (et souvent inaccessible), l'appartement du président du Congrès est un véritable trésor caché. Construit en 1875, en même temps que la salle du Congrès, par l’architecte Edmond de Joly, cet appartement d'apparat remplace l’ancien appartement du comte de Provence, frère de Louis XVI et futur Louis XVIII.
Il présente un décor néo-Louis XV aux accents très rocaille dans les salons et le bureau du président, et un style néo-Louis XIV pour la salle à Manger attenante.
Il a été restitué au château de Versailles par l'Assemblée nationale en 2006.
LA SALLE MARENGO
Cette salle, qui faisait partie des salles historiques du musée de Louis-Philippe consacrées au Consulat et au premier Empire de Napoléon Bonaparte, accueillait un grand tableau illustrant la bataille victorieuse de Marengo (1800).
Déplacé, il se trouvait à l’emplacement de l’entrée majestueuse de style Louis XIV de l’appartement du Président du Congrès réalisée par Edmond de Joly. On y observe aujourd’hui, entre autres, le célèbre tableau « Bonaparte franchissant le col du Grand Saint-Bernard » peint par Jacques-Louis David en 1800-1801.
La salle de Marengo servait pour le dépouillement lors des élections présidentielles de la IIIe et IV République.
LES SALONS EN ENFILADE ET LA SALLE À MANGER
Le premier salon qui ouvre l’appartement du Président du Congrès servait de bureau d’investiture pour les présidents de la République nouvellement élus. On prononçait le procès-verbal attestant de leur élection, et on leur remettait le collier de la Légion d’Honneur.
Le deuxième salon ouvre sur la salle à Manger, et le troisième accueille le bureau du président du Congrès.
Aujourd’hui, l’appartement sert pour les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat lors des réunions en congrès, mais aussi au président de la République lors de ses allocutions.
UN NOUVEL ACCROCHAGE PÉDAGOGIQUE
Pour célébrer les 150 ans de la IIIe République, un nouvel accrochage permanent d'œuvres des 19e et 20e siècles, issues des collections du château, est mis en place dans l’appartement du Président du Congrès. Portraits et bustes des présidents élus offrent un aperçu de la vie parlementaire sous la IIIe et IVe République.
INFORMATIONS PRATIQUES
Quoi ? La salle du Congrès et l’appartement du Président du Congrès
Où ? Château de Versailles
Quand ? Du 15 février à la fin du mois de septembre 2025
Tous les week-ends et jours fériés, en visite libre et en visite guidée
de 10h à 17h30 (jusqu’au 31 mars) et de 10h à 18h30 (à partir du 1er avril)
La semaine, en visite guidée uniquement
SOURCES
Visite personnelle commentée de la salle du Congrès et de l’appartement du Président du Congrès.
Dossier de Presse dédié







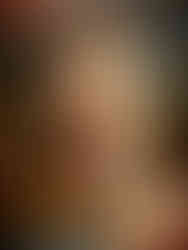



















































































































































































Casino Night propose des centaines de jeux, du classique au plus récent. Casino Night compte 72 fournisseurs de machines à sous vidéo. Jeux populaires de Yggdrasil, Quickspin, Playson, Big Time Gambling, ELK et d'autres fournisseurs bien connus. Les machines sont divisées en jackpots et nouveaux types. Étant donné que certaines machines à sous vidéo offrent un prize pool de 1 300 € et que d'autres offrent des jackpots progressifs de plus de 12 millions d'euros, les joueurs https://casinonightenligne.com/ sont particulièrement intéressés par ces derniers. D'autres ont près de 100 conceptions différentes. Des jeux de dés, de Keno, de Bingo, de cartes à gratter et de fléchettes sont proposés. Si vous vous ennuyez des machines à sous vidéo et d'autres jeux de casino,…