VISITE: LE PALAIS DE L’ÉLYSÉE, HAUT LIEU D’HISTOIRE(S) ET DE POUVOIR
- Igor Robinet-Slansky

- 2 déc. 2023
- 24 min de lecture

À l’occasion des 40e Journées Européennes du Patrimoine, qui ont ouvert les portes de nombreux sites et monuments -publics ou privés- aux curieux et passionnés du patrimoine historique et culturel sur l’ensemble du territoire, j’ai eu la chance de visiter l’un des lieux les plus emblématiques de notre pays et de son Histoire: le Palais de l’Elysée.
S’il s’agit aujourd’hui de la résidence officielle du Président de la République Française, cet hôtel particulier, bâti au 18e siècle, est en réalité riche d’une histoire de plus de 300 ans qui, des premiers propriétaires privés aux plus prestigieux personnages publics, a participé à l’écriture de certaines des pages le plus importantes de notre Histoire.
Édifié entre 1718 et 1722 pour le comte d’Évreux, l’hôtel particulier est acheté à sa mort par la favorite de Louis XV, la marquise de Pompadour. Devenu garde-meuble de la Couronne, puis propriété du banquier Nicolas Beaujon, de la duchesse de Bourbon, cousine de Louis XVI, et, après la Révolution, de Joachim et Caroline Murat, beau-frère et sœur de Napoléon 1er, il devient résidence de l’Empereur en 1809. C’est là, dans le salon d’Argent, que le 22 juin 1815, après les Cents Jours et la défaite de Waterloo, il signe son dernier acte d’abdication.
En 1848, élu 1er président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte choisit l’édifice comme le lieu du pouvoir, jusqu’au coup d’Etat de 1852 qui instaure le Second Empire (1852-70) et qui fait de lui Napoléon III. Il s’installe alors au Palais des Tuileries, et il faut attendre1870 et la 3e République pour que l’Élysée redevienne, jusqu’à aujourd’hui, la résidence de la Présidence.
Avant de partager avec vous la visite de certaines de ses pièces le plus emblématiques, je vous propose d’entrer plus en détails dans l’histoire de ce lieu d’exception.
L’ÉLYSÉE, 3 SIÈCLES D’HISTOIRE
L’histoire du Palais de l’Élysée commence dans la première moitié du 18e siècle, au début du règne du jeune roi Louis XV (règne 1715-1774). Le petit-fils de Louis XIV n’ayant pas encore atteint la majorité nécessaire pour gouverner (elle est alors fixée à 13 ans), le royaume de France est dirigé par le Régent, Philippe d’Orléans (1674-1723), neveu du Roi Soleil.
Cette période de Régence (1er septembre 1715–16 février 1723) est marquée par le retour de la cour à Paris, et donc par l’expansion de la capitale qui voit arriver de nombreux aristocrates qu’il faut loger. En 1718, l’un d’eux, Louis-Henri de la Tour d’Auvergne (1679-1753), comte d’Évreux, et proche du Régent, achète un terrain rue du Faubourg Saint-Honoré pour bâtir un hôtel particulier digne de son rang. A cette époque, le quartier est rustique et boisé, et la parcelle du comte, marécageuse, doit être assainie.
Quoi qu’il en soit, l’architecte Armand-Claude Mollet, mandaté pour la construction de cette résidence comtale, remplira sa mission et réalisera, entre 1715 et 1722, un hôtel qu’on appelle désormais l’Hôtel d’Évreux, et dont les dimensions sont dignes des plus nobles personnalités du royaume: un corps de logis central en pierre de taille sur deux étages, surmontés de combles brisés, et bordé, au nord, d’une cour pavée délimitée de chaque côté par les communs (bâtiments de service: cuisine, écuries…), et, au sud, de magnifiques jardins à la française.
Le comte d’Évreux jouira de sa prestigieuse propriété jusqu’à sa mort en 1753. Son hôtel, l’Hôtel d’Évreux, est alors mis en vente, et c’est la favorite du roi Louis XV, la célèbre Madame de Pompadour, qui l’acquiert. Elle en finira les décors intérieurs, et agrandira les jardins en mordant sur la largeur des Champs-Élysées. Cependant, la cour est revenue à Versailles avec le roi en juin 1722, et la marquise ne séjournera qu’épisodiquement dans sa résidence parisienne.
Cela étant dit, c’est assez amusant, je trouve, de se dire que nos présidents gouvernent et logent au sein de ce qui était alors le lieu des amours entre un roi et sa maîtresse.
Quoi qu’il en soit, à la mort de Madame de Pompadour en 1764, l’hôtel est récupéré par l’État pour y loger les ambassadeurs extraordinaires (sous l’Ancien régime, les ambassadeurs extraordinaires sont les ambassadeurs envoyés dans une cour pour une affaire particulière, par opposition aux ambassadeurs ordinaires qui, eux, résident de manière permanente en France). Mais il sert aussi pour entreposer les nombreuses œuvres d’art et le riche mobilier acquis par la marquise. Ainsi, dès 1765, l’édifice ouvre à la visite, avant de devenir, en 1768, le garde-meuble de la Couronne, dans l’attente que le nouveau bâtiment dédié, place Louis XV, soit terminé (c’est l’actuel Hôtel de la Marine place de la Concorde). La surface du jardin est raccourcie pour agrandir les Champs-Élysées voisins, mais il reste accessible à la population qui peut s’y promener.
Lorsque le nouveau garde-meuble de la Couronne ouvre à quelques pas de là, l’ancien hôtel particulier de la Pompadour est mis en vente. C’est Nicolas Beaujon (1718-1786), un riche banquier bordelais, qui en fait l’acquisition en 1773. Avec le concours de l’architecte Étienne-Louis Boullée, il apporte des modifications à sa nouvelle résidence pour lui donner le goût de son temps, plus proche du style Louis XVI, néo-classique, que du style Louis XV, rococo. Collectionneur d’art et en particulier de peintures, Nicolas Beaujon ouvre régulièrement son hôtel à la visite pour partager ses œuvres avec les Parisiens curieux. C’est à cette époque que l’hôtel prend le nom d’hôtel de l’Élysée, en référence au carré de l’Élysée, le jardin attenant bordant l’avenue des Champs-Élysées.

À la mort de Nicolas Beaujon en 1786, l’hôtel retrouve une propriétaire de sang royal en la personne de la princesse Louise Marie Thérèse Bathilde d’Orléans (1818-1822), duchesse de Bourbon, et cousine du roi Louis XVI (règne 1774-1792). Cette dernière acquiert l’Hôtel de l’Élysée qui prend alors le nom d’Hôtel de Bourbon ou «d’Élysée Bourbon». Elle l’agrandit et enrichit les décors de ses salons où elle organisera de somptueuses réceptions.
Mais le nom de Bourbon ne va pas plaire aux révolutionnaires et l’hôtel est confisqué pendant la Révolution. La duchesse survit aux violences et à la Terreur, et, après s’être exilée en Espagne, elle retrouve finalement son hôtel en 1797, sous le Directoire, le nouveau régime politique alors en place. Cependant, sans ressources, elle va décider d’ouvrir régulièrement sa propriété à la visite, et notamment son jardin agrémenté de grottes, cascades et labyrinthes. Elle loue également le rez-de-chaussée à un couple de flamands qui le transforme en lieu de plaisirs -bals, jeux, concerts et bien sûr, rencontres amoureuses. Après les troubles révolutionnaires, cet espace de vie et de fête est un succès. On y croise même Joséphine de Beauharnais, la future impératrice des Français. Des plaisirs qui s’interrompront avec le Consulat, ce nouveau régime politique qui, après le coup d’État du 18 Brumaire de l’an VIII (9 novembre 1799), porte à la tête du pays un héros de l’armée révolutionnaire, le général Napoléon Bonaparte (1769-1821). De Premier Consul, ce dernier devient empereur des Français en mai 1804.
L’hôtel de l’Élysée passe alors aux mains du maréchal d’Empire Joachim Murat (1767-1815), beau-frère de l’empereur Napoléon 1er -il a épousé sa sœur Caroline- qui l’achète le 6 août 1805. C’est avec eux que l’hôtel devient palais.
Le couple Murat engage de gros travaux de rénovation grâce aux architectes Barthélémy Vignon et Jean-Thomas Thibault. Sous l’impulsion de Caroline, les décors prennent alors un style tout à fait Premier Empire. Joachim Murat commande l’escalier d’Honneur à palmes dans le vestibule, et de grands espaces de réception sont aménagés, comme la salle de bal, dite alors Galerie des Tableaux, et aujourd’hui connue comme le salon Murat.
Lorsque Joachim et Caroline Murat sont nommés roi et reine de Naples en 1808, ils cèdent leur propriété à l’empereur qui y réside ponctuellement à partir de 1809 pour se retirer de la vie publique parisienne. Il aime à dire que ce palais est sa «maison de santé». C’est pourtant ici, dans le salon dit «salon d’Argent», qu’il signera son dernier acte d’abdication, le 22 juin 1815, avant de partir en exil forcé sur l’île de Sainte-Hélène où il mourra le 5 mai 1821.
Point Histoire: Napoléon Bonaparte en quelques lignes
Afin de mieux comprendre comment Napoléon en est arrivé à cette abdication, voici un retour (très) succinct sur sa vie et son parcours.
Napoleone Buonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio. Engagé dans les armées de la 1ère République Française, il en devient général en 1793 et brille par ses exploits militaires (campagnes d’Italie, d’Egypte).
Le coup d’État du 18 brumaire (9 nov. 1799) le propulse Premier Consul. Il dirige la France avec succès et, après plébiscite, il instaure l’Empire en mai 1804. Il est sacré Empereur des Français à Notre-Dame le 2 décembre 1804 avec son épouse, Joséphine de Beauharnais, qui devient l’impératrice Joséphine. Il divorcera d’elle en 1809 -elle ne peut lui donner d’héritier- et épousera l’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche, nièce de Marie-Antoinette. Ensemble ils auront un fils, le Roi de Rome, qui mourra en Autriche en 1832.
En 1812, la défaite contre la Russie et les tensions grandissantes en France marquent le début du déclin de l’Empire. En 1814, après des années de conquêtes victorieuses, Napoléon fait face à la coalition des puissances européennes. Il tient tête mais finit par plier, et le 30 mars, Paris capitule. Le 2 avril, le Sénat vote sa déchéance.
Réfugié à Fontainebleau, il abdique deux fois en deux jours: le 4 avril en faveur de son fils, puis le 6 définitivement. Reclus dans sa chambre, Napoléon tente sans succès de se suicider dans la nuit du 12 au 13 avril. Contraint de partir en exil sur l’Ile d’Elbe, au large de la Toscane, il met en scène ses adieux le 20 avril: il convoque sa garde, descend le célèbre escalier en fer à cheval du château, et prononce un discours poignant dans la cour d’Honneur qui devient pour l’Histoire «la cour des Adieux».
En France, c’est la période de la Restauration, marquée par le retour à la tête du pays d’un roi, Louis XVIII (règne 1814/15-1824), frère de Louis XVI.
Mais Napoléon réussit à s’échapper d’exil et à remonter vers Paris entre le 1er et le 20 mars 1815, motivant sur son passage l’armée et la population. Il s’arrête à Fontainebleau pour la dernière fois de sa vie le 20 mars 1815 avant de regagner Paris, d’où il règne de nouveau sur la France pendant «Cent Jours», depuis le Palais de l’Élysée -et non plus celui des Tuileries comme c’était le cas jusqu’alors. Mais après la défaite contre la coalition européenne à Waterloo (Belgique) le 18 juin, il est contraint d’abdiquer. Une abdication signée le 22 juin 1815 sur le bureau du salon d’Argent au Palais de l’Élysée.
Il se réfugie alors sur l’Île d’Aix avec l’idée de fuir aux États-Unis. Mais, berné par les Britanniques qu’il suit jusqu’en Angleterre, il est emmené en exil forcé à Longwood House sur l’île de Sainte-Hélène où il meurt le 5 mai 1821 à 17h49, à l’âge de 51 ans.
Après la chute du Premier Empire, sous la Restauration (1814-1830), qui voit remonter sur le trône les frères de Louis XVI, Louis XVIII (règne 1814/15-1824) et Charles X (règne 1824-1830); comme sous la Monarchie de Juillet qui, après une révolution les 27, 28 & 29 juillet 1830, est dirigée par le roi des Français Louis-Philippe 1er (règne 1830-1848), le Palais de l’Élysée sert tour à tour de résidence à des princes -notamment au duc de Berry, fils de Charles X-, puis à des hôtes étrangers de prestige.
Alors qu’une ultime révolution provoque la chute de Louis-Philippe en février 1848, la 2e République est instaurée et Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873), neveu de Napoléon 1er, est élu le premier président de la République Française en décembre 1848. Il décide de s’installer au Palais de l’Élysée qui devient le lieu central de l’État et prend provisoirement le nom «d’Élysée National». Un retour de courte durée puisqu’après son coup d’État du 2 décembre 1851 et sa proclamation de l’empire restauré, un an plus tard, le 2 décembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte, qui était jusque-là surnommé le «prince-président» en référence à sa lignée impériale, devient l’empereur Napoléon III. Sous le Second Empire (1852-1870), l’Élysée est délaissé pour le Palais des Tuileries, résidence emblématique des rois et empereurs régnants. L’ancien palais présidentiel accueille de nouveau les hôtes étrangers de l’État, et les salons sont redécorés dans un style très Second Empire: un style éclectique et historiciste, mélange d’influences du passé, délibérément somptueux et peu soucieux de la réalité historique, et qui met au centre l’esthétisme et le confort, dans une abondance de polychromie et d’ornementations élaborées. L’idée est avant tout d’impressionner et de traduire la grandeur de l’empire par un excès d’éléments décoratifs. Le palais sera ainsi également le lieu de nombreuses réceptions qui feront la réputation du faste impérial. Pour l’occasion, on décide de créer une grande salle de bal et de banquet, l’actuel salon Napoléon III.
Après la chute du Second Empire, conséquente à la défaite de la France dans la guerre engagée contre la Prusse en 1870, la 3e République, instaurée le 4 septembre 1870, investit de nouveau le Palais de l’Élysée qui redevient alors, et jusqu’à aujourd’hui, la résidence officielle du chef de l’État français. De nombreux aménagements sont faits à la fin du 19e siècle pour accueillir les services et l’administration de l’État, mais aussi les cérémonies officielles. C’est à cette époque, et à l’occasion de l’Exposition Universelle parisienne de 1889, que l’on va construire la célèbre et majestueuse salle des Fêtes de l’Élysée. On va dans le même temps créer des vestiaires attenants dans l’ancien jardin d’hiver bâti en 1881, sous la verrière, aujourd’hui célèbre lieu de conférences de presse avec son toit de verre tricolore réalisé par l’artiste Daniel Buren en 2018. C’est aussi à cette période que l’on va doter les lieux de l’électricité, du chauffage et de l’eau chaude, ainsi que de cuisines permettant d’organiser de véritables banquets d’état.
En 1958, avec l’arrive de De Gaulle et l’instauration de la 5e République, le président devient le personnage central de l’État, et le palais de l’Élysée prend toute son importance symbolique. Chacun des présidents y apportera son lot de transformations et de modernisations: Georges Pompidou (1911-1974) redécorera certaines pièces au goût du jour grâce à l’artiste-designer Paulin, Valéry Giscard d’Estaing (1926-2020) créera un PC nucléaire souterrain, et François Mitterrand (1916-1996) ajoutera à la salle des fêtes des grandes portes-fenêtres pour laisser entrer la lumière.
Vous connaissez désormais mieux la chronologie du palais de l’Élysée, cette résidence présidentielle qui, en 300 ans, a vu passé nombre de personnalités importantes et accueillis certains des événements les plus décisifs de notre histoire.
Je vous propose maintenant de me suivre dans une sélection de pièces et d’espaces remarquables du Palais de l’Élysées, que je vous présente dans l’ordre que j’ai suivi lors de ma visite. Une visite qui n’est possible qu’au moment des Journées Européennes du Patrimoine, sur réservation.
À LA DÉCOUVERTE DES PIÈCES REMARQUABLES DU PALAIS DE LÉLYSÉE
Vous allez le voir à travers la sélection de pièces emblématiques du Palais de l’Élysées décrites ici, ce qui est surprenant dans ce lieu riche d’Histoire, c’est le mélange des genres et des styles. D’une pièce à l’autre, les décors et l’architecture peuvent ainsi passer d’un style 18e à un aménagement Premier Empire, puis de décors Second Empire à des designs 20e ou 21e siècles plus contemporains.
LE REZ-DE-CHAUSSÉE
LE SALON D’ARGENT
Ce salon est présenté dans son état Premier Empire. C’est ici qu’aimait à se reposer Caroline Bonaparte, sœur de Napoléon, après qu’elle s’était installée à l’hôtel de l’Élysée avec son époux, Joachim Murat, en 1805. Le parme des tissus et peinture, et le blanc des boiseries sculptées de cygnes, de lyres et d’arabesques, accentuent le sentiment d’intimité qui se dégage des lieux. Notez que la soie des meubles était rouge à l’origine.
Cette pièce est petite par la taille, mais grande par les événements dont elle a été témoin. C’est ici que l’empereur Napoléon 1er, réfugié à l’Élysée après sa défaite de Waterloo en juin 1915, signera son acte d’abdication avant de connaître une fin tragique le 5 mai 1821 sur l’île de Sainte-Hélène où il sera exilé. On peut encore observer le fac-similé de ce document précieux de l’Histoire sur le bureau.
C’est également dans ce salon que le neveu de Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon, futur Napoléon III, prépare le coup d’État du 2 décembre 1851 qui aboutira à la restauration d’un régime impérial avec la naissance, le 2 décembre 1852, du Second Empire - dont la chute sera conduite par la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne de 1870, laissant place à la 3e République proclamée le 4 septembre 1870.
Mais c’est aussi ici et surtout que le président de la République Félix Faure mourra dans des circonstances pour le moins sulfureuses, le 16 février 1899.

Point anecdote: le coup de pompe de Félix Faure.
Le décès du président en exercice Félix Faure, élu le 17 janvier 1895, a fait couler beaucoup d’encre. Et pour cause! Sa mort, le 16 février 1899, à l’âge de 58 ans, est quelque peu inhabituelle et délicate pour le personnage central qu’est le président de la République. C’est en tout cas ce que l’on raconte depuis près de 125 ans. Mais, entre mythe et réalité, que s’est-il passé exactement?
Ce qui est communiqué officiellement au lendemain du décès de Félix Faure, président alors en fonction, c’est qu’il serait mort d’une «attaque d’apoplexie», soit d’un accident vasculaire cérébral. Cependant, très vite, les rumeurs se répandent concernant les circonstances de ce décès qui seraient plus douteuses et scandaleuses.
On raconte en effet que le président serait mort d’une crise cardiaque, certes, mais dans les bras de sa maîtresse, Marguerite Steinheil, en pleine partie fine, alors que les deux amants se trouvaient dans le salon d’Argent du Palais de l’Élysée.
Qu’en est-il vraiment? Pour le savoir, remontons au matin du 16 février 1899. Ce jour-là, dès son réveil, Félix Faure se sent fatigué, à tel point qu’il annule la promenade à cheval qu’il a l’habitude de faire quotidiennement. Il n’en oublie pas moins de donner rendez-vous à sa maîtresse, Marguerite Steinheil, surnommée Meg, à 17h l’après-midi même, après un conseil des ministres consacré à l’affaire Dreyfus qui divise alors la France.
Marguerite Steinheil est la femme de peintre Adolphe Steinheil (1850-1908). Félix Faure la rencontre à Chamonix en 1897 et, après plusieurs commandes passées par le président auprès de son mari, celle-ci devient l’une de ses maîtresses -le président est en effet un grand amateur de femmes. Les deux amants ont l’habitude de se retrouver dans le salon Bleu de l’Élysée, accessible par une porte dérobée, ou dans le salon d’Argent, pour quelques coquineries entre deux rendez-vous officiels.
Le président est cardiaque, il le sait, mais cela ne l’empêche pas d’utiliser régulièrement des aphrodisiaques pour rester fougueux devant ses maîtresses. Le jour de sa mort, alors que son conseil des ministres se termine, Félix Faure attend sa belle Marguerite. Il a ainsi demandé à l’un de ses huissiers de le prévenir par deux coups sur la porte lorsque celle-ci arrivera. Vers 17h, les deux coups résonnent. Le président s’empresse d’avaler une pilule aphrodisiaque mais, déception, il s’agit en fait de l’archevêque de Paris, François-Marie-Benjamin Richard, suivi d’Albert 1er de Monaco, venus défendre la cause du capitaine Alfred Dreyfus. Une fois les deux invités partis, cette fois, les deux coups sont frappés pour annoncer Marguerite. Félix Faure aurait alors avalé une seconde pilule d’aphrodisiaque. C’est là que les versions divergent.
La plus scandaleuse, relayée par la presse, et notamment les médias d’opposition, raconte qu’en plein acte sexuel, Félix Faure aurait été pris d’une attaque, criant et agonisant, au point d’alerter son directeur de cabinet, Louis Le Gall, qui décrira la scène dans ses mémoires: en entrant dans le salon d’Argent, affolé par les cris du président et de sa maîtresse, il aurait découvert l’homme le plus haut placé de la République affalé sur un divan, un gilet de flanelle comme seul vêtement, et près de lui, Marguerite Steinheil, les cheveux prisonniers par la main crispée de son amant. On aurait même dû lui couper quelques mèches pour la libérer, la laisser se rhabiller et surtout la renvoyer chez elle pour éviter tout scandale -Berthe Faure, l’épouse du président, étant en effet dans les locaux et pouvant débarquer à tout moment. Un prêtre aurait ensuite été fait appeler pour administrer les derniers sacrements. A son arrivée, et avant d’entrer dans le salon, il aurait ainsi demandé: «Le président a-t-il toujours sa connaissance?» -ce qu’on peut entendre de deux façons différentes, sa connaissance pouvant être sa conscience, comme faire référence à son invitée privée; ce à quoi on lui répondra: «Oui, elle est sortie par l’escalier de service!». Félix Faure serait ainsi mort trois heures plus tard, en présence de son épouse.
Cette rumeur se diffusant, elle s’est aussi amplifiée d’autres éléments encore plus croustillants. On écrira ainsi que Félix Faure serait mort en plein orgasme alors que sa maîtresse pratiquait sur lui l’art de la fellation. Cette légende a tellement été reprise que Marguerite Steinheil héritera du surnom de «Pompe Funèbre». Georges Clémenceau, fervent opposant au président, ajoutant foi à la légende, déclarera: «Il se croyait César, il n’est mort que Pompée!». Ici aussi, le double sens fait référence aux goûts fastueux de Félix Faure, mais aussi, bien sûr, à sa mort scandaleuse.
Cependant, les historiens s’accordent désormais sur une version moins grivoise de cette mort présidentielle. En effet, Félix Faure, sujet à la tachycardie, aurait été stressé par son entretien avec Albert 1er de Monaco au sujet de l’affaire Dreyfus: Faure condamnant le capitaine, le prince souhaitant son acquittement. Ces échanges houleux et la fatigue du président, connu pour ses abus -maîtresses, cigares, bonne cuisine et bons vins-, auraient entraîné un malaise cardiaque. Le président aurait bien passé quelques instants avec sa maîtresse, mais, ne se sentant pas bien, il aurait pris congés d’elle et serait retourné à son bureau où il serait mort, entouré de sa famille et de son médecin. Finalement, la légende viendrait des opposants au président, ayant eu vent de son entrevue avec sa maîtresse, mais aussi de Marguerite Steinheil elle-même qui aurait raconté une version des faits qui lui donne un rôle central.
La vérité n’éclatera certainement jamais complètement sur ce scandale qui fait vibrer l’histoire de la République et du palais de l’Élysée depuis plus d’un siècle. A chacun de juger et de choisir la version qu’il ou elle préfère.
Le salon d’Argent sera par la suite le témoin d’autres anecdotes, comme en 1974, où un inconnu, qui avait réussi à s’infiltrer dans l’Elysée par les jardins, est retrouvé ici, faisant sa sieste.
Cette petite pièce riche d’histoires servira de bureau pour Danielle Mitterrand et Bernadette Chirac. Par la suite, les conjointes du président choisiront le salon des Fougères, appelé aussi salon Bleu, autre lieu de rendez-vous de Félix Faure et de ses maîtresses.
LA SALLE À MANGER PAULIN
Cette salle à Manger était auparavant la chambre de Napoléon III. En 1972, Sous le mandat de Georges Pompidou (présidence: 1969-1974), l’ensemble de cette pièce est redécorée dans un style contemporain très années 1970 par l’architecte designer Pierre Paulin.
La structure des murs blancs, entièrement démontable en polyester moulé et laqué, sont surmontés d’un impressionnant plafond-lustre composé de 9000 tiges et billes de verre. Le mobilier en aluminium est recouvert du même matériau que celui des cabines de la fusée Apollo qui transportera les premiers hommes sur la Lune le 21 juillet 1969.
Le tableau triptyque coloré est, lui, signé de l’artiste Alfred Manessier.
LA BIBLIOTHÈQUE NAPOLÉON III
Ici, plusieurs hôtes et résidents se son succédé dans ce qui a longtemps été une chambre à coucher. Sous la Restauration, il s’agit de la chambre du duc de Berry, neveu de Louis XVI et fils du roi Charles X (règne 1824-1830). Sous le Premier Empire, c’est celle de Caroline et Joachim Murat, puis de Napoléon 1er. Ce n’est qu’en 1860, sous le Second Empire, qu’elle devient la bibliothèque de l’empereur Napoléon III. Sous la Présidence de la République, elle devient un bureau, un salon ou même un fumoir sous Georges Pompidou. Elle sert aujourd’hui de salle à Manger.
On peut y observer un bar original créé par l’artiste François-Xavier Lalanne, le «Bar aux autruches». Il est composé de deux grands oiseaux, chacun d’eux pouvant contenir des bouteilles, et d’un œuf, au milieu, qui sert de seau à glace. Le fond de la pièce est orné, depuis février 2023, de l’œuvre de Justin Weiler, «Dédale». Les 14 panneaux en verre feuilleté, entièrement peints à a main à Rennes, rappellent le labyrinthe dans lequel Dédale enferma le Minotaure dans la mythologie grecque.
LE SALON DES FOUGÈRES, BUREAU DE DU OU DE LA CONJOINT.E DU PRÉSIDENT
Originellement connu comme le salon Bleu, ce salon a pris le nom de salon des Fougères en raison des motifs actuels de sa tenture murale. Des motifs créés à l’origine pour la chambre à coucher de Louis XVI au château de Compiègne et repris ici à la demande du Président Valéry Giscard d’Estaing qui souhaitait une décoration plus classique que son prédécesseur Georges Pompidou qui fera, lui, entrer le design contemporain à l’Élysée. Depuis 2007, cet ancien salon de réception sert de bureau pour la conjointe ou le conjoint du Président ou de la Présidente de la République.
LE SALON DE LA CARTOGRAPHIE
Sous Napoléon III, ce salon marquait l’entrée des appartements privés. Il était décoré de tapisseries reprenant la carte de la forêt de Compiègne, d’où son nom de salon de la Cartographie. Un nom qui inspirera le président Valéry Giscard d’Estaing qui y installera des boiseries illustrées de cartes du monde contemporain -Moyen-Orient, Israël, territoires palestiniens, Afrique…
Dans les années 1970, sous la présidence de Georges Pompidou, ces cartes, le sol, les murs et le plafond sont dissimulés sous des milliers de rectangles multicolores par l’artiste Yaacov Agam. Un décor aujourd’hui remplacé par des lambris blancs et or -celui des années 1970 est désormais conservé au Centre Pompidou. Par la suite, ont été installées des œuvres de Victor Vasarely et Jean Degottex, et, plus récemment, un tapis de Jean Gardair réalisé en 2006 à partir de d’eau de Javel et ainsi nommé à juste-titre, Les Javels.
LE SALON DES PORTRAITS
Ici, au Premier Empire, se trouvait le bureau de l’empereur Napoléon 1er. On y admirait alors des portraits de la famille impériale que l’un des résidents d’alors, le maréchal d’Empire Joachim Murat, beau-frère de Bonaparte, avait fait installer.
Lorsqu’il fait de l’Élysée la résidence de la République, le président Louis-Napoléon Bonaparte, qui n’est pas encore l’empereur Napoléon III, choisit d’utiliser cette pièce comme salle du conseil des ministres. En lieu et place des portraits des Bonaparte, il fait poser ceux de huit souverains européens. Il s’agit d’affirmer sa légitimité et de s’imposer comme l’égal des grands dirigeants de l’Europe. Sur les portraits exposés ici, on peut ainsi observer: le pape Pie IX, l’empereur François-Joseph d’Autriche, le roi Victor-Emmanuel d’Italie, le tsar Nicolas 1er de Russie, la reine Victoria du Royaume-Uni, le roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse, la reine Isabelle II d’Espagne, le roi Guillaume 1er de Wurtemberg.
Rénovée en 2019 dans son décor 18e d’origine, avec lambris blancs et boiseries dorées, ce salon accueille aujourd’hui les dîners en petits comité de la présidence de la République.
LE SALON POMPADOUR
Au 18e siècle, se trouvait ici la chambre de Parade du comte d’Évreux, premier propriétaire des lieux, puis, à partir de 1753, celle de la marquise de Pompadour. C’est ici que la célèbre favorite de Louis XV recevait ses invités. Les boiseries datent de l’époque de la construction de l’hôtel, tandis que les dessus de porte peints par Charles Chaplin, représentant quatre déesses de la mythologie romaine, ont été posées sous le Second Empire. En effet, lorsque le président Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III en 1852, suite à son coup d’État, il quitte l’Élysée pour les Tuileries. Son ancienne résidence devient celle de ses hôtes étrangers prestigieux. Afin de montrer sa puissance, le nouvel empereur fait redécorer certaines pièces comme ici où sur les boiserie on peut voir son portrait.
Le salon Pompadour accueille aujourd’hui certaines audiences du président de la République. Plus rarement, ce-dernier peut y servir à dîner, comme ce fût le cas le 18 novembre 1989 où, après la toute récente chute du Mur de Berlin (dans la nuit du 9 au 10 novembre), François Mitterrand rassemble ici les chefs d’État européens autour d’un dîner afin d’évoquer l’avenir face à la fin de la Guerre Froide.
Le mobilier, contemporain, s’accorde aujourd’hui avec des œuvres d’art comme la tapisserie de Joan Miro ou le tapis d’Étienne Hajdu.
LE SALON DES AMBASSADEURS
Ce salon, aux décors 18e, tient son nom de la fonction qu’il remplit encore aujourd’hui: c’est ici que depuis la fin du 19e siècle, les lettres de créance des ambassadeurs étrangers sont remises. En effet, c’est le président de la république qui, en signant une lettre de créance, valide la nomination des ambassadeurs étrangers en France.
Depuis 2017, cette pièce accueille également chaque mercredi le conseil des Ministres.
La table Medulla, créée en 2022, est le résultat d’une collaboration entre l’Atelier de Recherche et de Création du Mobilier National et de quatre étudiants de l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art Olivier de Serres (ENSAAMA), à Paris. Il s’agissait de concevoir une table modulable (de 20 à 40 assises), et facilement démontable, pour recevoir le conseil des Ministres.
LE SALON DES AIDES DE CAMP
Sous le Premier Empire, étaient accueillis ici les aides de camp, ces jeunes officiers qui, sous l’autorité d’un général, transmettaient les ordres sur le champ de bataille.
Le décor, restauré au 19e siècle, date de la construction de l’hôtel particulier dans les années 1720. Napoléon III y ajoutera les dessus de porte peints par Charles Landelle en 1859.
Aujourd’hui, le salon des aides de camp est le salon d’accueil des invités du président. Restauré en 2018, il est aménagé d’un salon dessiné par le designer Thierry Lemaire.
LE VESTIBULE D’HONNEUR ET L’ESCALIER MURAT
Avec son escalier orné de feuillage, et sa vue sur la cour d’Honneur où sont accueillis tous les invités de la Présidence de la République, le vestibule est sûrement l’un des lieux les plus célèbres du Palais de l’Élysée.
Lorsque depuis la cour, on gravit les marches qui mènent au perron puis dans l’entrée du palais, on ne peut s’empêcher de ressentir une certaine émotion, comme un sentiment de déjà-vu. Face à nous, une étonnante sculpture en marbre blanc. Réalisée par l’artiste Arman, et intitulée «Hommage à la Révolution de 1789», elle a été commandée par le président François Mitterrand en 1984 afin de rappeler à tous le rôle fondateur de la Révolution Française pour la République et nitre société actuelle.
Le vestibule d’Honneur abrite un autre chef-d’œuvre bien connu: l’escalier Murat. Alors propriétaires de l’Élysée, Joachim Murat, maréchal et beau-frère de Napoléon 1er, et son épouse Caroline Bonaparte, décident de construire un nouvel escalier pour l’entrée de leur palais. C’est chose faite en 1806, avec cet escalier à double volée de marches, bordé par une rampe en plomb doré ornée de motifs impériaux, et notamment de barreaux en forme de palmes, symboles de Victoire, qui semblent jaillir de couronnes d’olivier, et qui sont surmontées d’un rampe de feuillage.
Le tapis, plus contemporain, est une œuvre de l’artiste Nathalie Junod-Ponsard qui, par ses couleurs saturées, donne l’impression que le visiteur marche sur la lumière.
LE SALON MURAT
Ce salon de réception est créé et décoré pour Joachim Murat et son épouse, Caroline Bonaparte, en 1807. On y trouve de grands tableaux rappelant des scènes importantes de la vie de ce maréchal du Premier Empire, fidèle beau-frère de Napoléon 1er: Murat franchissant victorieusement le Tibre avec sa cavalerie, lors de la campagne d’Italie (1796-97); la famille Murat contemplant, depuis sa calèche, son château de Benrath, près de Düsseldorf; ou encore, représentée entre deux fenêtres, la colonne de Trajane élevée à Rome au 2e siècle et qui inspirera la colonne Vendôme à Napoléon -ici, Murat rend hommage à l’empereur des Français qui, comme l’empereur romain, bâtira une colonne à la gloire de ses victoires.
Autres pièces remarquables: le bureau plat réalisé par Charles Cressent vers 1745. Il s’agit du bureau utilisé par Félix Faure, président entre 1895 et 1899, puis par ses successeurs dont le général de Gaulle (président de 1958 à 1969). Il est aujourd’hui exposé ici, le bureau du président accueillant du mobilier plus contemporain.
C’est dans ce salon d’apparat que, le 10 décembre 1848, fût installé un bureau de vote pour organiser les premières élections présidentielles de la 2e République. Ce jour-là, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l’empereur, devient ainsi le premier président de la République française. Il s’installe alors à l’Élysée, renommé sous cette 2e République, «Élysée National». Le salon Murat porte l’empreinte de ce prince-président qui, devenu Napoléon III en 1852, et après avoir épousé son impératrice, Eugénie, en 1853, intègrera aux boiseries le chiffre composé de trois initiales entrelacées: N, B & E. On peut y lire: Napoléon Bonaparte & Eugénie, ou Napoléon Bonaparte, Empereur, ou encore, le E peut-il être lu comme un 3, pour Napoléon Bonaparte 3.
Le salon Murat sera aussi le témoin d’un événement important de l’histoire européenne en janvier 1963. C’est en effet ici que le président Charles de Gaulle et le chancelier allemand Adenauer signeront l’acte fondateur de la réconciliation entre la France et l’Allemagne.
Jusqu’en 2017, et depuis le mandat de Georges Pompidou (président de 1969 à 1974), ce salon accueillera le conseil des ministres.
LE SALON NAPOLÉON III
C’est Napoléon III qui, en 1860, décide de construire ici, ce salon de réception, en lieu et place de l’ancienne Orangerie. Cette pièce peut alors servir de salle à Manger comme salle de Bal. Au départ, ce salon était ouvert sur le parc, mais à la création du jardin d’Hiver attenant en 1881, on va percer son plafond de trois coupoles pour lui apporter la lumière nécessaire.
D’ailleurs, cette grande salle richement décorée, tout en dorures typiquement Second Empire, est aussi un savant mélange des époques qu’elle a traversé jusqu’à aujourd’hui: sur les angles du plafond, on peut observer l’aigle impérial, anachroniquement surmonté des initiales R.F., soit République Française.
Aujourd’hui, le salon Napoléon III est toujours utilisé pour les réceptions officielles.
LE JARDIN D’HIVER
Lorsqu’il est bâti en 1881 à la demande du président de la 3e République, Jules Grévy (1807-1891 / Présidence: 1879-1887), le jardin d’Hiver sert de passage couvert entre le palais et le jardin, et abrite de nombreuses plantes. Aujourd’hui, il est utilisé pour les réceptions officielles et pour les conférences de presse du président de la République.
Restaurée en 2018, sa verrière a été remplacée par une installation Bleu-Blanc-Rouge de l’artiste français Daniel Buren. Une œuvre monumentale qui habille de lumière cette galerie.
LA SALLE DES FÊTES
C’est certainement la pièce la plus impressionnante du palais de l’Élysée, ou tout au moins la plus grande avec ses 600 mètres carrés. La salle des Fêtes a été construite par l’architecte Eugène Debressenne pour l’Exposition Universelle de 1889, sous la présidence de Sadi Carnot (1837-1894 / Présidence: 1887-1894, il est mort en fonction, assassiné). Le plafond, aux décors de style Napoléon III, rend gloire aux arts et aux sciences avec notamment trois médaillons peints par Guillaume Dubufe, où l’on voit la France soutenir les progrès scientifiques et artistiques.
Ici son organisées les cérémonies officielles, comme les dîners d’État, l’investiture des présidents de la République, ou encore les remises de Légion d’honneur.
Percée de dix portes-fenêtres en 1984 à la demande de François Mitterrand, afin d’y laisser entrer la lumière naturelle, la salle des Fêtes a été rénovée en 2018 par le Mobilier National, l’agence Isabelle Stanislas, et l’OPPIC (Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture).
C’est une salle où les visiteurs restent un moment tant les décors y sont nombreux et chargés.
LE PREMIER ÉTAGE
Après avoir gravi l’escalier Murat depuis le vestibule d’Honneur, le premier étage, qui s’ouvre par le palier des Huissiers, marque l’entrée des espaces dédiés au pouvoir présidentiel. C’est le passage tant attendu des visiteurs de l’Élysée!
L’ANTICHAMBRE
L’antichambre du Palais de l’Élysée, comme toute antichambre, sert de salle d’attente pour les visiteurs et invités du président de la République.
Elle est aujourd’hui décorée de tapisseries de la sculptrice argentine Alicia Penalba, installée en France depuis les années 1950.
LE SALON VERT
Le salon Vert est un salon plutôt richement décoré qui doit son nom aux boiseries vertes et dorées, ornées d’arabesques de style Louis XV, qui habillent ses murs. Ce style Louis XV ne date pas du 18e siècle. Il s’agit d’une version revisitée pour Napoléon III dans un style néo-rocaille aux goûts du Second Empire. À cette époque, le salon Vert est utilisé comme salle à manger par l’impératrice Eugénie. Plus tard, c’est ici que Charles de Gaulle organisera ses conseils des ministres. Aujourd’hui, le président y tient des réunions avec ses proches conseillers et son chef de cabinet.
LE SALON DORÉ, BUREAU DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Situé au cœur de l’édifice, le salon Doré est la pièce maîtresse du premier étage et, finalement, du Palais de l’Élysée. C’est en effet le bureau actuel du président de la République, depuis que le général de Gaulle l’a adopté comme tel. Seul Valéry Giscard d’Estaing lui préfèrera un bureau annexe.
Les boiseries dorées et le décor luxueux ont été réalisés en 1861 par Jean-Louis Godon à la demande de l’impératrice Eugénie. C’est en effet ici qu’elle passera ses premières nuits après que Napoléon III lui a demandé sa main, en 1853. Une pièce chargée de souvenirs, donc, pour elle. On peut d’ailleurs observer au-dessus des portes le chiffre «NE» pour Napoléon & Eugénie.
Ce salon est aujourd’hui meublé de pièces contemporaines, notamment le bureau du président créé par Thierry Lemaire et installé ici par Emmanuel Macron. Jusqu’alors, et depuis la présidence de Félix Faure (1895-1899), tous les présidents de la République utilisaient un bureau d’époque Louis XV réalisé par l’ébéniste Charles Cressent (1685-1768).
Plusieurs œuvres d’art agrémentent également les lieux, comme ce tableau de Pierre Soulages ou ce «Sablier Millénaire» imaginé par l’artiste Benoît Pype en 2021, et qui doit mettre exactement 1000 ans à s’écouler.
LA COUR D’HONNEUR
C’est par cette cour mythique et très médiatique que le président, ses ministres et ses invités entrent au Palais de l’Élysée.
Sa forme en hémicycle, choisie par le comte d’Évreux dès la création de son hôtel particulier en 1718, permettait aux carrosses de circuler et manœuvrer facilement. Les ailes qui l’encadrent et qui accueillent aujourd’hui des bureaux, servaient alors pour les communs (cuisines, écuries….).
SOURCES
Visite du Palais de l’Élysée
Livret édité par la Présidence de la République : « Élysée, le Palais des Français »
https://www.herodote.net/16_fevrier_1899-evenement-18990216.php

































































































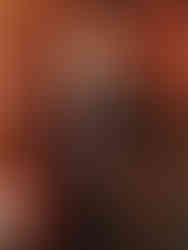



































































































































































































































Passionnant et magnifiquement illustré.