LA MAISON DES JARDIES À SÈVRES : DE BALZAC À GAMBETTA
- Igor Robinet-Slansky

- 30 août 2025
- 9 min de lecture

On a beau vivre à Paris depuis des années, la capitale et ses alentours ne tarissent pas de surprises pour les amoureux du patrimoine. Alors que je cherchais de nouveaux lieux à explorer, c’est à Sèvres que mes recherches m’ont conduit, et plus précisément à la Maison des Jardies, célèbre pour avoir accueilli deux grandes figures françaises du 19e siècle: l’écrivain Honoré de Balzac, puis l’homme politique Léon Gambetta qui y mourra en 1882.
Cette Maison des Illustres est située à une dizaine de kilomètres de Paris, et à seulement cinq minutes de marche de la gare de Sèvres Ville d’Avray - à une vingtaine de minutes de la gare Saint-Lazare en Transilien (Ligne L, gratuite avec le pass Navigo).
Bonus : gérée par le Centre des monuments nationaux (Cmn), la Maison des Jardies est donc accessible gratuitement pour celles et ceux qui possèdent la carte Passion Monuments. Disponible à partir de 45€ par an, cette carte est indispensable aux amoureux de patrimoine et donne accès à plus de 100 monuments du Cmn partout en France.
Suivez-moi sans plus attendre dans l’histoire et la visite de la Maison des Jardies.
LA MAISON DES JARDIES : DE BALZAC…
Bâtie sur le versant sud du domaine de Saint‑Cloud, la Maison des Jardies est une humble maison de vigneron. Son nom vient du lieu-dit des Jardies, où se trouvaient à l’origine des jardins et terrains agricoles, notamment des vignobles.
La Maison devient célèbre lorsqu’en 1837, Honoré de Balzac (1799-1850) s’y installe. L’écrivain rêve alors d’y finir ses jours, et même de lotir le terrain pour alléger ses dettes. Il n’habite cependant pas dans la maison que l’on visite, qui était plus petite et réservée à son jardinier, Pierre Brouette (ça ne s’invente pas !). Il vivra, lui, dans une demeure bourgeoise plus cossue aujourd’hui disparue.
Mais Balzac, qui continue de s’endetter, sera malheureusement contraint de vendre son domaine des Jardies en 1840. Il ne reste ainsi aujourd’hui plus vraiment de traces de son passage aux Jardies, si ce n’est un buffet rescapé des saisies, et présenté dans la cuisine de l’actuelle maison, que l’écrivain aurait, dit-on, caché aux huissiers.
… À LÉON GAMBETTA
En 1878, Léon Gambetta (1838-1882), en quête d’un lieu paisible pour se reposer de sa vie politique bien remplie, acquiert la Maison des Jardies. Il s’agit ici du logis du jardinier, qui sera agrandi, et non de l’ancienne demeure de Balzac. Gambetta s’installe ici avec sa compagne, Léonie Léon (1838-1906).
Le logis est étonnamment modeste pour une personnalité politique aussi réputée. Il se compose de quatre pièces au rez-de-chaussée (cuisine, office, salle à manger et salon), une chambre et un cabinet de toilette pour Léon Gambetta au premier, et la même configuration au dernier étage pour Léonie (un second étage que l’on ne visite pas aujourd’hui).
Malheureusement, à peine quatre ans après son installation dans son havre de paix, Léon Gambetta s’éteint dans son lit de la Maison des Jardies, le 31 décembre 1882.
À seulement 44 ans, il meurt des suites d’une péritonite provoquée par une blessure à la main accidentelle, survenue quelques semaines auparavant alors qu’il nettoyait un pistolet (les balles sont visibles dans la salle à manger de la maison).
Il est alors enterré à Nice avec son père. Mais si son corps y repose toujours, son cœur, lui, a été transféré au Panthéon le 11 novembre 1920.
Pour en savoir plus sur Léon Gambetta, rendez-vous dans l’article dédié à l’entrée de Gambetta au Panthéon sur mon blog, ou dans la partie consacrée dans cet article.
LA MAISON DES JARDIES APRÈS GAMBETTA
La mort de Léon Gambetta transforme immédiatement la Maison des Jardies en lieu de pèlerinage républicain, pour les hommes politiques comme pour les admirateurs de celui qui fût l’un des pères fondateurs de la Troisième République (Proclamation de la République le 4 septembre 1870 à la chute du Second Empire, puis élaboration des lois qui instaurent officiellement la République Française et ses principes le 30 janvier 1875).
En 1887, après avoir revendu les parcelles de terrains qui l’entouraient, la famille décide de léguer la demeure à l’État français, qui, le 8 novembre 1891 y inaugure un monument hommage. Érigé à la demande de sa sœur, Benedetta Gambetta, et financé par le Comité des Alsaciens-Lorrains - en souvenir du soutien de l’homme politique au maintien en France de ces territoires - le monument est réalisé par le célèbre sculpteur alsacien Auguste Bartholdi (le père de la Statue de la Liberté).
La maison est classée monument historique en 1991 et obtient le label « Maison des Illustres » en 2011. Aujourd’hui, elle se visite (en visite guidée ou en visite libre, voir les informations pratiques). Si la chambre est présentée telle qu’elle était à la mort de Gambetta, les autres pièces de la maison ont été remeublées, avec justesse, dans le style de l’époque.
VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DES JARDIES
La visite s’organise principalement dans la maison, mais aussi dans le jardin - ce qu’il en reste car il a été drastiquement réduit en raison de l’urbanisation. C’est là que se trouve le monument hommage à Gambetta que l’on peut explorer.
LES PIÈCES DU REZ-DE-CHAUSSÉE
La visite débute par la cuisine, où l’on entre – à l’époque, on était reçu par la salle à manger. Sobre et sommaire, cette pièce évoque la présence d’Honoré de Balzac aux Jardies.
On peut, entre autres, y voir une tête monumentale de Balzac, réalisée en plâtre par Auguste Rodin vers 1898. Refusée à l’époque pour son audace, cette tête servit pourtant de modèle à la sculpture en bronze que l’on peut admirer aujourd’hui à Paris. Un témoignage fort du génie créatif de Rodin… et de l’image intemporelle de Balzac.
Le parcours nous conduit ensuite à l’office, où l’on explore, à travers tableaux, photographies et documents, la vie personnelle de Léon Gambetta, son entourage, ses parents et sa compagne Léonie Léon.
La salle à Manger, par où les habitants entraient auparavant, présente ensuite des objets et documents évoquant la carrière politique de Léon Gambetta : médailles, articles de presse, bustes, tableaux…
On pénètre alors dans la dernière pièce du rez-de-chaussée : le salon. Au milieu des tapis et papiers-peints fleuris, on ressent clairement ici l’atmosphère qui pouvait régner à la fin du 19e siècle. On observe, exposés, diverses représentations de Léon Gambetta, qu’elles soient caricaturales ou à sa gloire, mais aussi une série de photographies révélant ce à quoi ressemblaient l’intérieur de la maison lorsqu’il y vivait.
LES PIÈCES INTIMES À L’ÉTAGE
La suite de la visite nous mène au premier étage réservé alors aux pièces personnelles de Léon Gambetta.
La chambre à coucher plonge avec émotion le visiteur dans l’intimité de Gambetta. On y découvre son lit, où il meurt le 31 décembre 1882, son bureau (même s’il s’était fait construire un kiosque dans le jardin pour bénéficier d’un bureau et d’une bibliothèque plus spacieux), mais aussi différentes images de l’homme sur son lit de mort, ou de ses funérailles nationales, grandioses.
Enfin, le cabinet de toilette attenant – qui ne conserve aujourd’hui de toilette que le nom - présente des objets, photographies ou documents témoignant du culte voué à Léon Gambetta après sa mort ici, dans la maison des Jardies, ou plus généralement en France – de nombreuses villes donneront son nom à des rues, avenues ou places, et d’autres érigeront des monuments et statues en son honneur.
Parmi les objets remarquables que l’on peut observer ici, on découvre le coffret en merisier et noyer qui a accueilli son cœur après sa mort. D’abord déposé en 1891 sous son monument à Sèvres, il sera transféré le 11 novembre 1920 au Panthéon lors d’une grande cérémonie républicaine. Aujourd’hui, ce coffret est exposé ici, comme un témoin silencieux de la mémoire de Gambetta et de la République.
LE JARDIN ET LE MONUMENT À GAMBETTA
Si les extérieurs - qui s’étendaient sur 4 hectares à l’époque de Balzac, puis 6000m² sous Gambetta - sont aujourd’hui réduit à peau de chagrin (sans mauvaise référence à l’œuvre de Balzac), il est néanmoins possible de faire le tour de la maison et de gravir quelques marches pour gagner l’arrière du monument dédié à Gambetta. Il est préférable de l’observer depuis la rue, mais ici, on peut y pénétrer et l’explorer plus en détail.
Le monument inauguré en 1891 et réalisé par le sculpteur alsacien Auguste Bartholdi, présente au centre une statue de Gambetta qui fait l’éloge de ses actions envers la défense nationale et de son soutien à l’Alsace et la Lorraine dont il n’admettra jamais la cession à l’Allemagne. Il est d’ailleurs représenté ici portant contre son cœur les drapeaux des deux provinces perdues, et, gisant à ses pieds, un aigle impérial symbole de la chute du Second Empire et de la renaissance de la République.
Enfin, lorsque l’on ouvre la grille qui permet d’y entrer, on découvre une plaque qui rappelle qu’ici, sous ce monument - et jusqu’à son entrée au Panthéon - se trouvait le cœur de Léon Gambetta.
La visite se termine donc ici, à l’arrière de cette œuvre allégorique à la gloire du Gambetta combattif et républicain.
À PROPOS DE LÉON GAMBETTA
Fils d’immigrés italiens, Léon Gambetta naît le 2 avril 1838 à Cahors. Il est nationalisé Français à 21 ans, alors qu’il étudie le droit à Paris où il fréquente les milieux républicains. Avocat en 1860, il se fait remarquer en 1869 en défendant le journaliste républicain Charles Delescluze, initiateur d’une souscription pour ériger un monument en hommage au député républicain Alphonse Baudin tué sur une barricade alors qu’il manifestait contre le coup d’Etat du futur Napoléon III en 1851. Dès lors, Gambetta devient une figure de l’opposition au régime autoritaire et liberticide du Second Empire (1852-1870).
En 1869, candidat républicain aux élections législatives à Marseille et dans le département de la Seine, il rédige le «programme de Belleville» prônant la liberté de la presse, le suffrage universel, la séparation de l'Église et de l'État, l'école gratuite, laïque et obligatoire, l’impôt sur le revenu… Il est élu mais la guerre franco-prussienne éclate le 19 juillet 1870, et le 1er septembre, la France perd à Sedan où Napoléon III est capturé et capitule le 2.
Le 4 septembre suivant, à Paris, devant l’Assemblée Nationale, une foule motivée par les républicains exige la déchéance de l’empereur et, incitée par une partie des députés menés par Gambetta et Jules Favre, elle se rend à l’Hôtel de Ville où est proclamée la IIIe République.
Toujours présents sur le territoire français, les Prussiens assiègent Paris le 19 septembre. Ministre de la Guerre puis de l’Intérieur, Gambetta s’enfuit le 7 octobre en montgolfière depuis la butte Montmartre pour gagner Tours où le gouvernement s’est réfugié, puis Bordeaux.
Finalement, le 18 janvier 1871, l’Allemagne proclame son unité au château de Versailles et le 26 janvier, l’armistice est signé. Des élections sont organisées et le nouveau gouvernement à majorité monarchiste d’Adolphe Thiers, ancien ministre du roi Louis-Philippe, négocie la paix. La France doit payer et abandonner l’Alsace et la Moselle.
En désaccord, Gambetta démissionne du gouvernement le 6 février. Il est néanmoins élu dans 9 départements aux élections législatives organisées le 8 février, et il choisit symboliquement de représenter le Bas-Rhin destiné à devenir allemand. Il va cependant de nouveau démissionner quand l’Alsace-Lorraine est cédée à la nouvelle Allemagne.
Déçu, il part pour l’Espagne. Il ne sera pas en France lors de l‘épisode de la Commune de Paris (18 mars-28 mai 1871). À son retour en juin, il est élu député de la Seine. Leader du groupe parlementaire l’Union Républicaine, il critique l’Assemblée Nationale toujours à majorité monarchique, et en 1875, il contribue à faire voter les Lois Constitutionnelles sur lesquelles il a travaillé, et qui instaurent définitivement la IIIe République et en organisent les pouvoirs – des lois votées au château de Versailles le 30 janvier 1875.
En 1876 et en 1877, il contribue aussi au succès des Républicains qui sont majoritairement élus aux élections législatives. Il prend ensuite la présidence de la Chambre des Députés en 1879, puis il est nommé Président du Conseil (notre Premier Ministre) en novembre 1881. Le 14 janvier 1882, il dépose un projet de réforme constitutionnelle pour un exécutif plus fort mais il échoue, et le 30 janvier son gouvernement tombe.
Il se retire alors dans sa maison des Jardies à Sèvres. C’est là qu’il meurt d’une pérityphlite (inflammation du gros intestin), le 31 décembre 1882, à la suite d’une blessure à la main survenue par accident alors qu’il nettoyait un pistolet un mois plus tôt.
Grand orateur, engagé pour plus de justice et d’égalité, Léon Gambetta est un homme politique emblématique de la figure républicaine. Son cœur sera transféré au Panthéon le 11 novembre 1920 à l’occasion des 50 ans de la IIIe République, et deux ans après l’armistice de la première guerre mondiale.
INFORMATIONS PRATIQUES
Quoi ? La Maison des Jardies
Où ? 14, avenue Gambetta - 92310 Sèvres
Quand ? La Maison des Jardies est ouverte les mercredis, les jeudis et un week-end sur deux (sauf exception).
Visite commentée à 14h30, puis visite libre de 16h à 18h30.
Combien ? Tarif unique : 7€ (Voir ici les conditions de gratuité)
Toutes les informations, la programmation et les réservations ici, sur le site de la Maison des Jardies.
SOURCES
Visite commentée de la maison.
Document de visite remis à l’accueil.
Le site du Cmn.

































































































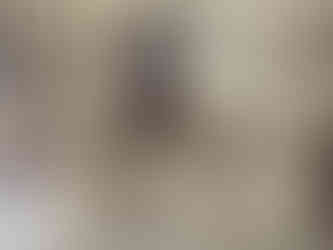







































































































Looking for top interior designers in Bangalore? Find your perfect match. Browse curated profiles, stunning portfolios, and client reviews to start your dream project today.